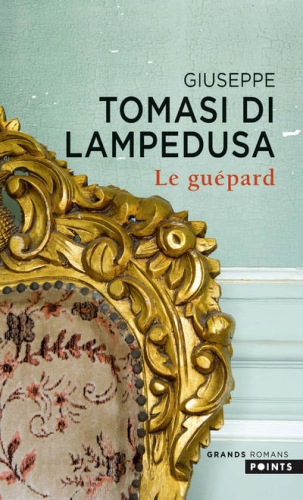Enfin la Sicile !
- Publié le Lundi 15 novembre 2021
- par Serval
 0 commentaire
0 commentaire
Trois mois après la fin de ma longue marche jusqu’à l’extrême sud italien, je peux confirmer n’avoir aucun remords d’avoir décidé, une fois arrivé à Salerne, de ne plus me diriger vers Syracuse mais vers Santa Maria di Leuca. La fin de mon périple, à travers le sud de la Campanie, la Basilicate et les Pouilles, jusqu’au bout du talon de la botte italienne, a été un plaisir de chaque instant que même la canicule des deux dernières semaines n’a pas réussi à atténuer.
Pas de remords donc, ce choix de changer de destination fut le bon. Mais des regrets… oui bien sûr. Un rêve inachevé laisse forcément des regrets.
C’est en avion que j’ai finalement atteint la Sicile il y a quelques jours pour un séjour touristique banal, à Palerme puis… à Syracuse où sévissaient la tempête et les inondations. Ce n’est certes pas ainsi que j’avais imaginé atteindre un jour Ortigia et le Castello Maniace mais finalement, j’y suis arrivé ! Bien content d’ailleurs de dormir sous un toit pendant que sévissait un ‘Medicane’ (ouragan méditerranéen) empêchant quiconque de mettre le nez dehors.
J’en ai profité pour me plonger dans la lecture du Guépard, magnifique roman sicilien dont l’adaptation cinématographique par Luchino Visconti a remporté en 1963 la Palme d’Or du Festival de Cannes.
|
« Angelica et Tancredi passaient en ce moment devant eux, la main droite gantée du jeune homme posée à la hauteur de la taille d’Angelica, les bras tendus et entrelacés, les yeux de chacun rivés dans ceux de l’autre. Le noir du frac, le rose de la robe, mêlés, formaient un étrange bijou. Ils offraient le plus pathétique des spectacles, celui de deux très jeunes amoureux qui dansent ensemble, aveugles à leurs défauts respectifs, sourds aux avertissements du destin, dans l’illusion que tout le chemin de la vie sera aussi lisse que les dalles du salon, acteurs inconscients qu’un metteur en scène fait jouer dans les rôles de Roméo et Juliette en cachant la crypte et le poison, déjà prévus dans l’œuvre. Ni l’un ni l’autre n’était bon, chacun était plein de calculs, gros de visées secrètes ; mais ils étaient tous les deux aimables et émouvants tandis que leurs ambitions, peu limpides mais ingénues, étaient effacées par les mots de joyeuse tendresse qu’il lui murmurait à l’oreille, par le parfum de ses cheveux à elle, par l’étreinte réciproque de leurs corps destinés à mourir. » Giuseppe Tomasi di Lampedusa — Le guépard (Points Seuil) |
Le Soleil des Scorta (Laurent Gaudé)
- Publié le Mercredi 30 septembre 2020
- par Serval
 0 commentaire
0 commentaire
Le soleil du mois d’août écrase le massif du Gargano. Ayant atteint le sommet de « ce qui semblait être la dernière colline du monde », l’homme hébété de chaleur perché sur le dos de son âne se dirige vers Montepuccio, le village des Pouilles dont il a été chassé quinze ans plus tôt, pour revoir enfin la femme à laquelle il n’a cessé de penser en prison.
Par le viol qu’il va commettre – mais qui, en fait, n’en sera pas un – et par l’erreur qu’il fait alors en prenant Immacolata Biscotti pour sa sœur décédée, Luciano Mascalzone va être à l’origine de la lignée des Scorta : son fils Rocco le bandit, les trois enfants de celui-ci (Domenico Mimi va fan’culo, Giuseppe Pepe pancia piena et Carmela Miuccia) auxquels s’adjoignent le « frère adoptif » Raffaele Faelucc’ et bientôt la génération suivante avec Elia et Donato, puis la suivante encore avec Anna.
À sa mort, Rocco a fait don de tous ses biens à l’Eglise pour que les siens, désormais, « ne soient plus fous, mais pauvres », les libérant ainsi de la malédiction familiale et leur permettant de devenir de bons chrétiens et de prospérer. Comme Faelucc’ le dira à son neveu Elia bien des années plus tard : « il faut profiter de la sueur » – ce qui veut dire que les années de labeur sont les plus heureuses de la vie.
Désormais réduits à la misère, Domenico, Giuseppe et Carmela s’embarquent pour tenter leur chance à New-York mais ils sont refoulés à Ellis Island et doivent revenir en Italie. C’est sur le bateau du retour qu’il vont gagner, grâce à leur travail et à l’entregent de Carmela, ce qu’ils appelleront « l’argent de New-York », mise de départ pour créer leur entreprise familiale, un bureau de tabac à partir duquel la famille va se faire une place au soleil. Ils vont travailler, travailler, travailler, tout gagner et choisir de tout perdre, dans la sueur et dans le silence car, si l’amour est partout, les mots sont rares chez les Scorta.
Voilà un très beau roman écrit par un amoureux de l’Italie qui connaît particulièrement bien la région du Mezzogiorno où l’histoire se déroule, cet ergot de la botte italienne où la terre, couverte de poussière et d’oliviers, est écrasée de soleil et de religion et où la mer, éblouissante et bleue, porte des barques de pêcheurs, des trabocchi et des contrebandiers. Les phrases sont courtes et sèches comme la terre des Pouilles ; on les lit comme on lirait un conte, la saga légendaire d’une famille construite au fil des générations, d’abord méprisée, puis crainte, puis admirée, mais toujours liée par l’amour et le respect de sa terre, de son sang et de son nom.
|
« Les olives sont éternelles. Une olive ne dure pas. Elle mûrit et se gâte. Mais les olives se succèdent les unes aux autres, de façon infinie et répétitive. Elles sont toutes différentes, mais leur longue chaîne n’a pas de fin. Elles ont la même forme, la même couleur, elles ont été mûries par le même soleil et elles ont le même goût. Alors oui, les olives sont éternelles. Comme les hommes. Même succession infinie de vie et de mort. La longue chaîne des hommes ne se brise pas. Ce sera bientôt mon tour de disparaître. La vie s’achève. Mais tout continue pour d’autres que nous.» Laurent Gaudé — Le Soleil des Scorta (Actes Sud) |
Dans la forêt (Jean Hegland)
- Publié le Lundi 20 avril 2020
- par Serval
 0 commentaire
0 commentaire
Nell a 17 ans. C’est son journal que nous lisons, rédigé sur le cahier qu’Eva, son aînée d’un an, lui a offert pour le premier Noël qui a suivi la mort de leurs parents. Les deux sœurs ont toujours vécu dans leur maison familiale, au cœur d’une grande forêt du nord de la Californie. Elles étudiaient avec acharnement, Nell pour intégrer Harvard, Eva pour devenir ballerine. Leur vie était heureuse jusqu’à la mort de leur mère, d’un cancer, quelques mois plus tôt, même si le monde qu’elles ont toujours connu avait déjà commencé à s’effondrer.
Autour d’elles et de leur père, en effet, tout se détériore peu à peu. L’électricité va et vient puis disparaît. Le téléphone, internet, la poste, plus rien ne fonctionne. Les magasins ferment, les trains et les avions ne circulent plus. Protégées par leur isolement, elles apprennent par touches que des troubles ont eu lieu dans le pays et ailleurs sur la planète, qu’il y a des épidémies, des crues, peut-être un accident nucléaire, mais finalement aucun événement initial bien identifié qui signerait le début de cette fin du monde.
Livrées à elles-mêmes après la mort accidentelle de leur père, les deux sœurs doivent apprendre à survivre et à vivre ensemble. Elles vont faire leur deuil d’un monde qui n’existe plus et de rêves d’avenir qui n’ont plus aucun sens. Devenues adultes en peu de temps, il leur faut subvenir à leurs besoins essentiels et pour cela apprivoiser la nature qui les entoure.
À la fois roman post-apocalyptique, roman écologique et roman d’apprentissage, et soutenu par une splendide écriture, « Dans la forêt » — dont la publication aux États-unis date de 1996 — est l’un de ces rares livres qu’on voudrait pouvoir lire à la fois très lentement pour en déguster chaque phrase et à toute vitesse pour connaître la suite… un livre qui marque et dont on se souvient.
|
« Au début, quand le courant sautait alors que nous préparions un repas, nous sortions le réchaud à gaz Coleman et terminions la cuisson sur les brûleurs qui sifflaient, jusqu’au jour où nous n’avons plus pris la peine de ranger le Coleman. Lorsque nous avons fini la dernière bonbonne de gaz et qu’à la quincaillerie on n’en vendait plus nous avons trouvé comment cuire des pommes de terre sous le charbon du poêle dans le salon et appris à faire sauter des pancakes, à cuire des haricots à l’eau et du riz à la vapeur sur le dessus. [...] Notre père a creusé un trou dans le ruisseau, l’a tapissé de pierres et de sacs-poubelle en plastique noir, l’a recouvert avec un panneau de signalisation CÉDEZ-LE-PASSAGE qu’il avait récupéré autrefois à la déchetterie, et l’a fièrement appelé « réfrigérateur ». » Jean Hegland — Dans la forêt (vf. Gallmeister, 2017) |
À la ligne (Joseph Ponthus)
- Publié le Mardi 21 mai 2019
- par Serval
 0 commentaire
0 commentaire
Joseph Ponthus, qui travaillait comme éducateur spécialisé en région parisienne, a démissionné pour rejoindre la femme qu’il aime à Lorient. Mais voilà , une fois en Bretagne, pas moyen de trouver un poste dans son domaine. Il a alors recours aux agences d’intérim qui lui proposent des contrats « d’opérateur de production » dans l’industrie alimentaire.
En clair, il travaille désormais à la chaîne — pardon, à la ligne — là où on a besoin de sa force de travail pendant quelques jours ou quelques semaines. Tri de crevettes, usine de poissons panés, égouttage de tofu, nettoyage d’abattoirs, déplacement de centaines de carcasses de bovins, composent désormais son quotidien.
Ponthus n’est pas un ouvrier classique. Il a une formation littéraire et un besoin d’écrire qui l’amène à raconter ce quotidien par touches successives au fil des mois qui s’écoulent. Usine et écriture. La ligne dont il est question, c’est à la fois la ligne de production et chacune des lignes d’écriture qui se succèdent en retours rapides dans ce récit fait d’une prose qui ressemble à des vers.
Au fil du temps et des courts chapitres, l’auteur dévoile peu à peu des pans de son monde. Ses études littéraires, l’amour pour sa femme — pudiquement effleuré et toujours présent — ses collègues, les chefs, les monceaux d’animaux morts, son chien Pok-Pok, sa maman.
Ni pathos ni misérabilisme dans ces « feuillets d’usine » ; pas de plainte malgré les douleurs et l’épuisement physique ; une résilience de tous les instants, de tous ces jours sans fin qui se suivent. Pour tenir, il a la littérature, romans et poèmes, les chansons de Trenet, ses souvenirs et la routine.
Voilà un grand livre. Un « récit prolétarien » comme on n’en avait pas lu depuis plusieurs dizaines d’années, et qui se passe ici et maintenant. En France, au XXIe siècle.
|
« C’est ignorer jusqu’à l’usine qu’on pouvait Réellement Pleurer De fatigue Ça m’est arrivé quelques fois Hélas non quelquefois Rentrer du turbin Se poser cinq minutes dans le canapé Et Comme un bon gros point noir que tu n’avais pas vu et qui explose à peine tu le touches Je repense à ma journée Sens mes muscles se détendre Et Explose en larmes contenues Tâchant d’être fier et digne Et ça passera Comme tout passe La fatigue les douleurs et les pleurs Aujourd’hui je n’ai pas pleuré » Joseph Ponthus — À la ligne (La Table Ronde, 2019) |
L’archipel d’une autre vie (Andreï Makine)
- Publié le Vendredi 8 juin 2018
- par Serval
 0 commentaire
0 commentaire
Dans les années 1970 du « communisme vieillissant qui coïncida avec notre jeunesse », selon les mots du narrateur, celui-ci est un adolescent, orphelin de deux « héros du peuple », qui apprend sans entrain le métier de géomètre aux confins de la Sibérie extrême-orientale. Désœuvré, il s’apprête à partir randonner dans la taïga lorsque son attention est attirée par un mystérieux inconnu qui, lui aussi, s’y enfonce. Sans bien savoir pourquoi, il commence à le suivre en cachette. En fait, l’inconnu a immédiatement remarqué qu’il était suivi et à l’occasion du premier bivouac, neutralise le garçon. Se rendant compte de son caractère inoffensif, il lui offre du thé et l’interroge sur sa vie, avant de lui raconter la sienne…
En 1952, pendant la guerre de Corée, Pavel Gartsev est un jeune homme de 27 ans cantonné dans l’extrême-orient sibérien avec des dizaines d’autres soldats dont les autorités soviétiques testent la résistance en cas de conflit atomique. Un détenu dont on ne sait rien s’est échappé et s’est enfoncé dans la taïga, il faut le rattraper. Les soldats Gartsev et Vassine sont désignés pour assister dans cette mission le commandant Boutov, le capitaine Loukass et le sous-lieutenant Ratinsky.
Au fil des jours et des nuits de poursuite, le fugitif fait montre d’une ruse et d’une connaissance de la taïga qui mettent à rude épreuve ses poursuivants. Feux de camps multiples pour déjouer ceux qui le traquent, pièges en tous genres, gibier empli d’herbes soporifiques qui endorment leur chien, l’inconnu a plus d’un tour dans son sac. Au fil des jours, ses relations avec ses poursuivants deviennent presque intimes, tandis que les personnalités des cinq soldats se révèlent au grand jour. Le commandant Boutov, amateur de vodka et finalement assez brave homme, tremble devant le véritable chef de l’expédition, le capitaine Loukass, à qui sa fonction de responsable politique donne le pouvoir d’écrire des rapports qui signifient la vie ou la mort ; le sous-lieutenant Ratinsky, lâche et arriviste, est torturé par des rêves dans lesquels des nuques accusatrices le regardent, celles des nombreux hommes qu’il a exécutés d’une balle ; Mark Vassine, qui pleure la mort de son chien tué par le maladroit Ratinsky, se sent vite solidaire de l’inconnu dont il est le premier à découvrir l’identité. Comme Gartsev, il lui vient bientôt secrètement en aide. C’est grâce à ce fugitif, Elkan – dont je ne dirai rien – que Pavel Gartsev réussira à vaincre son « pantin de chiffon », comme il appelle la peur qui est en lui.
Le titre du roman trouve enfin son explication dans la dernière partie du roman, lorsque Gartsev finit de raconter son histoire, une histoire de chasse à l’homme dans des paysages magnifiques au sein desquels il faut déchiffrer des empreintes, suivre des traces, traverser des fleuves à gué, repérer des feux de camp, marcher, chasser et dormir. Une histoire qui, bien qu’elle commence un demi-siècle plus tard, m’a fait irrésistiblement penser au magnifique livre de Vladimir Arseniev, Dersou Ouzala, et au film tout aussi splendide qu’Akira Kurosawa en a tiré.
C’est surtout l’histoire d’êtres humains dont très peu réussissent à vivre, alors que beaucoup meurent et que la plupart se contentent d’exister. Un très grand livre, un de ces rares textes qu’on referme avec les larmes aux yeux, non par tristesse mais à cause de leur beauté et du bonheur qu’on a ressenti à les lire.
|
« Bientôt, ses trois feux brillèrent. Dans l’encoignure d’un repli boisé, je distinguais sa silhouette qui passait devant les flammes. [...]
Auparavant, nous étions plusieurs et je ne pouvais supposer [...] qu’une attitude nous visant tous : sa peur, son dégoût, sa volonté de fuir cette meute de militaires, tantôt veules, tantôt agressifs. Désormais, il n’y avait que moi – un homme, éreinté par la poursuite, le mauvais sommeil, le nourriture insuffisante [...] J’avais allumé un feu, préparé un repas et je restais immobile, le regard perdu dans les flammes. Je humais le même air empli de douceur méridionale, entendais la même plainte monocorde d’un oiseau survolant nos deux refuges. Chacun de nous percevait ces minutes intimes égarées dans le temps ample et vague de la taïga. Jamais je n’avais été uni à quelqu’un par un lien aussi transparent. » Andreï Makine — L’archipel d’une autre vie (Seuil, 2016) |